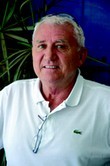
Jardins du Maroc : Vous avez réalisé un des jardins remarquables de la région d’Essaouira. Il se trouve le long de l’ancienne seguia qui apportait l’eau à la ville d’Essaouira, sans doute à l’emplacement d’une ancienne villa romaine car certains indices militent en ce sens. Votre propriété a été occupée, tour à tour, par le garde forestier, Monsieur Perret, puis par Lahcen Achkoun et enfin par le Danois, Monsieur Flemming. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous rencontré ce pays ?
Philippe Cachet : Je suis né à Taroudant en 1953. Mademoiselle Guéry et sa mère furent mes institutrices. Je suis né d’une mère rbatie, c’est-à-dire d’une Française née elle-même à Rabat où mon grand père fut directeur de la banque d’État au début du siècle dernier. Mon oncle fut un ami très proche de Ben Barka. Il est mort à Rabat d’un accident. Il se nommait Marc Renner. Il était à moitié suisse et à moitié français. Son nom complet était Renner de Bresle. Après mes premières études à Taroudant, je suis parti au lycée d’Agadir et puis j’ai dû me rendre à Casablanca en pensionnat chez les pères de l’Institution Charles de Foucauld. J’y suis resté quatre ou cinq ans. Mon père était agriculteur dans le Sous. Il produisait des oranges et des clémentines dans des champs qui tiraient leur eau d’un puits qui, à l’époque, cherchait l’eau à une profondeur de 65 mètres. J’ai été fasciné, durant mon enfance, par un arbre que possédait mon père qui donnait à la fois des clémentines, des pamplemousses et des citrons. Cela avait été obtenu, bien sûr, par une double greffe sur un arbre tuteur. Il s’agissait d’une incertitude identitaire par adoption imposée par l’homme. On rentrait alors dans un état de fascination devant un être qui était lui-même devenu transgenre.
Jardins du Maroc : Avez-vous cherché, vous aussi, à faire des greffes ?
Philippe Cachet : J’ai fait effectivement des greffes sur un bougainvillier qui donne, à partir du même tronc des fleurs bleues et blanches.
Jardins du Maroc : Avez-vous un souvenir précis de votre petite enfance ?
Philippe Cachet : Oui. Il y a un événement qui m’a marqué. Il eut lieu au moment de l’Indépendance. J’avais alors trois ans. Une nuit, une horde de gens était venue pour encercler notre ferme et nous attaquer. Mais tous les employés ont fait comme un mur. Ils ont réalisé un barrage de leurs corps pour nous protéger et ils sont parvenus à renvoyer tout le monde. Cependant, mes parents ont eu peur et ils nous ont envoyés en France. C’est une angoisse infantile qui a eu des effets par la suite. J’ai horreur de la foule, je ne sais pas si cela vient de là, mais je n’aime pas les grandes manifestations, qu’elles soient positives ou négatives. Je n’ai jamais participé à un mouvement de foule et je n’y participerai jamais.
Jardins du Maroc : Comment avez-vous conçu ce jardin ?
Philippe Cachet : J’ai toujours aimé les jardins, je ne sais pas pourquoi. Il est vrai que je suis fils de paysans. De plus, j’ai la main verte. Il m’arrive de prendre des tuteurs en bois, de le mettre en terre et ils reprennent, ce qui était considéré dans les récits hagiographiques des saints marocains comme étant un indice de baraka. Est-ce en raison de cela, mais je crois que j’ai la baraka.
Ce jardin d’Essaouira est historiquement lié à celui du parc de la Gazelle d’or de Taroudant. Il en est comme un fils symbolique. Je m’explique. Mes parents furent des amis du baron Pellenc qui a construit la Gazelle d’or à Taroudant. Et j’étais très admiratif de cet homme qui était un artiste. Il a, en effet, construit la Gazelle d’or et son jardin en tant qu’artiste et non en tant qu’entrepreneur : il faisait des erreurs. On voyait les murs sortir de terre, mais l’homme insatisfait mettait tout à terre et il recommençait jusqu’à ce que sa réalisation corresponde à ses souhaits. Pour moi, ici, ce fut la même chose dans la réalisation de ce jardin. Les plans sur papier ne me parlaient pas du tout. J’ai donc agi de la même manière, construit puis cassé des murs et recommencé. La construction des structures de ce jardin fut donc très longue. Elle dura quatre ans, même avec l’aide d’un professionnel.
Jardins du Maroc : Ce jardin est construit sur une structure tripartite à l’endroit de l’ancienne seguia. Ceci limite le regard et l’on ne découvre la troisième partie, la plus vaste, une sorte de jardin à l’anglaise, doté de cages où se trouve un faucon et des cailles, qu’après avoir franchi la dernière porte. Comment ce jardin a-t-il été façonné ?
Philippe Cachet : Il y a, en cet endroit, une contrainte évidente. Nous n’avons ici que du sable. Nous sommes sur des dunes et c’est ce qui explique la présence de la maison forestière où habita l’homme qui a succédé à l’ingénieur Wattier, laquel fut le premier à avoir consolidé le système dunaire d’Essaouira pour permettre le développement de la ville et mettre fin aux tempêtes de sable. Ce sable est récent dans l’histoire. En effet, on trouve la couche d’argile primitive à seulement 1,5 ou 2 mètres de profondeur.
On a commencé par réaliser le jardin qui est aujourd’hui le plus proche de la maison. Ce n’est que progressivement que furent réalisées les seconde et troisième parties du jardin. La troisième partie comporte aussi le terrain qui est à proximité de la maison principale, mais sur la hauteur.
Au départ, j’ai planté un peu au hasard, comme dans une pépinière. Au fur et à mesure que les plantes ont commencé à grandir, j’ai commencé à avoir une idée plus précise de ce que serait ce jardin. Pour cela, il a fallu élaguer, arracher et replanter ailleurs certaines plantes qui ne pouvaient rester dans leurs places primitives, car je voulais avoir la diversité la plus grande possible. Quelques obstacles s’ajoutèrent à la contrainte du sable. Il y a ici des araignées rouges, mais je ne mets aucun produit de traitement, faisant confiance en la sélection naturelle. Je ne mets, par ailleurs, que des engrais naturels, en particulier du fumier. Pour modifier le sol, nous avons fait venir presque 300 camions de terre. Il ne s’agit pas de la terre de Chichaoua qui est un peu compacte. La terre que nous avons ici est très légère. Nous l’avons mélangée au sable. Pour cette raison, elle nécessite beaucoup d’arrosages, mais heureusement, on trouve l’eau à 4,5 mètres de profondeur.
En souvenir de la ferme paternelle, j’ai essayé de planter ici des agrumes. Je ne voulais, dans un premier temps, que des arbres qui apportent quelque chose d’utile à l’homme, qui produisent des pamplemousses, des navels ou des clémentines, mais cela n’a pas marché. J’ai fait un autre essai en m’éloignant des agrumes. J’ai donc essayé par la suite de produire des avocats, des pommes ou des prunes, mais, là aussi, cela n’a pas marché. J’ai abandonné l’idée des cultures utilitaires.
Il y avait avant, sur ce terrain, des cyprès. Il y en avait même beaucoup trop. J’en ai gardé quatre et replanté les autres dans la partie du fond du jardin. J’ai aussi gardé un magnifique pin parasol, un arbre imposant qui est, sans doute, le seul dans toute la région, l’autre qui existait un peu plus haut, avait été coupé pour son bois avant mon arrivée. Je ne sais toutefois pas exactement s’il y en a d’autres dans la région.
J’ai donc franchi le pas vers les arbres de décoration. J’ai acheté des palmiers Washingtonia et Phoenix. Depuis peu, j’ai un nouveau palmier où les feuilles poussent en vrilles. Je l’ai obtenu chez le pépiniériste d’Azrou au nord d’Agadir. Certains palmiers viennent, pour leur part, de Marrakech ou de la vallée de l’Ourika. Parmi les autres arbres, je possède quelques oliviers et surtout un arbre odorant qui sent très fort en début de nuit, yasmin al-charq. J’ai aussi mis un hibiscus rouge.
Jardins du Maroc : Le fait d’être personnellement daltonien a-t-il eu une influence sur votre jardin ?
Philippe Cachet : J’ai évité de mettre des plantes qui produisent de la couleur rouge.
Jardins du Maroc : C’est une forte contrainte pour les fleurs.
Philippe Cachet : Les fleurs ont eu beaucoup de mal à s’adapter à ce type de terrain. On peut faire une exception pour les géraniums, les pervenches de Madagascar et les rosiers que je commence à réussir à cultiver. Pour chaque fleur, j’essaye divers emplacements. Il y a, en effet, des endroits où cela marche, tout particulièrement pour les fleurs qui n’aiment pas le vent. Il ne faut pas non plus trop d’arrosage, en particulier pour les cannas. J’ai ainsi réussi à faire fleurir ici plusieurs variétés de marguerites. Celle qui produit des fleurs jaunes ne marche pas bien. Les autres, celles qui donnent des fleurs violettes ou bleues, poussent bien surtout celles qui ont des fleurs violettes très foncées. Les pétunias fleurissent assez bien ainsi que les capucines, mais comme j’ai un paon, il mange ces fleurs.
Jardins du Maroc : Pourquoi avez-vous mis du gazon, ce qui paraît étrange dans un jardin situé au Maroc ?
Philippe Cachet : J’ai dû mettre ici de l’herbe, contraint et forcé, à cause du vent et de la poussière pour protéger cet espace du sable sinon il serait invivable.
Jardins du Maroc : La troisième partie de ce jardin diffère des deux autres. Les chemins n’y sont plus droits, mais en courbe. Pourquoi ?
Philippe Cachet : Tout ce que j’enlève du jardin principal et de ses deux parties, je le replante là-bas. C’est un espace différent avec une déclivité. La morphologie du terrain permet d’autres perspectives.
Jardins du Maroc : Vous avez utilisé des cactées ?
Philippe Cachet : J’ai mis beaucoup de plantes grasses. On trouve des cactées un peu partout. C’est parce qu’elles donnent des fleurs extraordinaires, une fois par an. Cela me permet d’avoir un jardin en fleur tout le temps, car ces plantes commencent à fleurir fin novembre. Cela complète donc les floraisons que donnent les fleurs plus classiques comme les strelitzias que j’aime beaucoup. Mais on peut voir aussi des daturas. J’ai découvert des daturas violet foncé. Il s’agit de daturas nains. J’ai remarqué qu’ils se reproduisaient rapidement. Les graines tombent sur le sol et donnent sans difficulté naissance à de nouvelles fleurs.
Jardins du Maroc : Avez-vous importé des plantes ?
Philippe Cachet : Je suis parti avec une remorque en France pour y chercher des pins parasols ainsi qu’un bananier importé de Guadeloupe qui donne des bananes très petites et très larges avec un arrière-goût de pomme. J’avais rapporté aussi des cocotiers, mais ils n’ont pas tenu. J’ai aussi amené ici des pieds de piment de Guadeloupe. Il s’agit de gros piments. J’ai eu du mal à faire vivre ces piments dans le sable mélangé à de la terre. En revanche, ils se développent fort bien dans des pots remplis de terre. Le laurier-sauce pour la cuisine prend bien également. J’en avais énormément, je les ai donc enlevés, mais je m’en suis mordu les doigts car il est ensuite impossible d’en faire partir un autre. On a aussi de la canne à sucre. Il s’agit de la grande canne que j’ai plantée en trois endroits différents.
Jardins du Maroc : Qu’avez-vous observé de remarquable dans ce jardin ?
Philippe Cachet : Une plante est, un jour, venue toute seule, apportée par un oiseau, mais elle a disparu maintenant car les jardiniers l’ont enlevée. Elle donnait des petits fruits que l’on trouve dans le commerce. Ils sont comme des tomates-cerises. Ces fruits sont de couleur orangée. Il y a comme une feuille qui enferme le fruit. Cela se mange. Je pense que l’on appelle cette plante le « coqueret du Pérou ». J’avais recherché des graines en France, car cette plante a peu de maladies. Elle se développe très rapidement et se consomme facilement.
Jardins du Maroc : Y a-t-il eu une autre observation qui mérite d’être rapportée ?
Philippe Cachet : L’expérience la plus étonnante que j’ai faite concerne une plante que j’ai rapportée ici. Il s’agit du fruit de la Passion. J’en ai ramené deux plants de Guadeloupe. Ils ont eu du mal à démarrer. Puis ils ont très bien pris, mais ils ne font pas de fruits. Ils font la fleur, mais elle ne se transforme pas en fruit. Quelle est la cause de cela ? Est-ce dû à la chaleur ? Je ne sais pas. J’ai aussi fait une autre observation. Elle se rapporte à un hibiscus ramené de l’île des Saiès qui est située près de la Guadeloupe. Cette plante, à l’origine, était blanche et, avec le sol d’ici, elle est sortie rose clair. Cela se passe aussi avec les hortensias ou avec les iris de Toulouse qui normalement, dans leur biotope d’origine sont violets et qui, ici, deviennent blancs. Ces changements de couleurs concernent aussi les fleurs des arbres greffés quand la variété artificiellement créée par l’homme retourne à la variété d’origine. C’est une chose que je ne comprends pas trop. Il y a un autre fait : les hibiscus rouges fleurissent toute l’année alors que les blancs n’ont pas de fleur de décembre à avril-mai. Ils font plus de fleurs, mais celles-ci deviennent laides. On peut penser que les variétés d’origine étaient, sans doute, rouges. Le bougainvillier blanc a aussi plus de mal à prendre que les autres, mais alors, il fleurit plus, à tel point qu’on ne voit plus les feuilles. Ce jardin est une source d’émerveillements perpétuelle.


 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur
